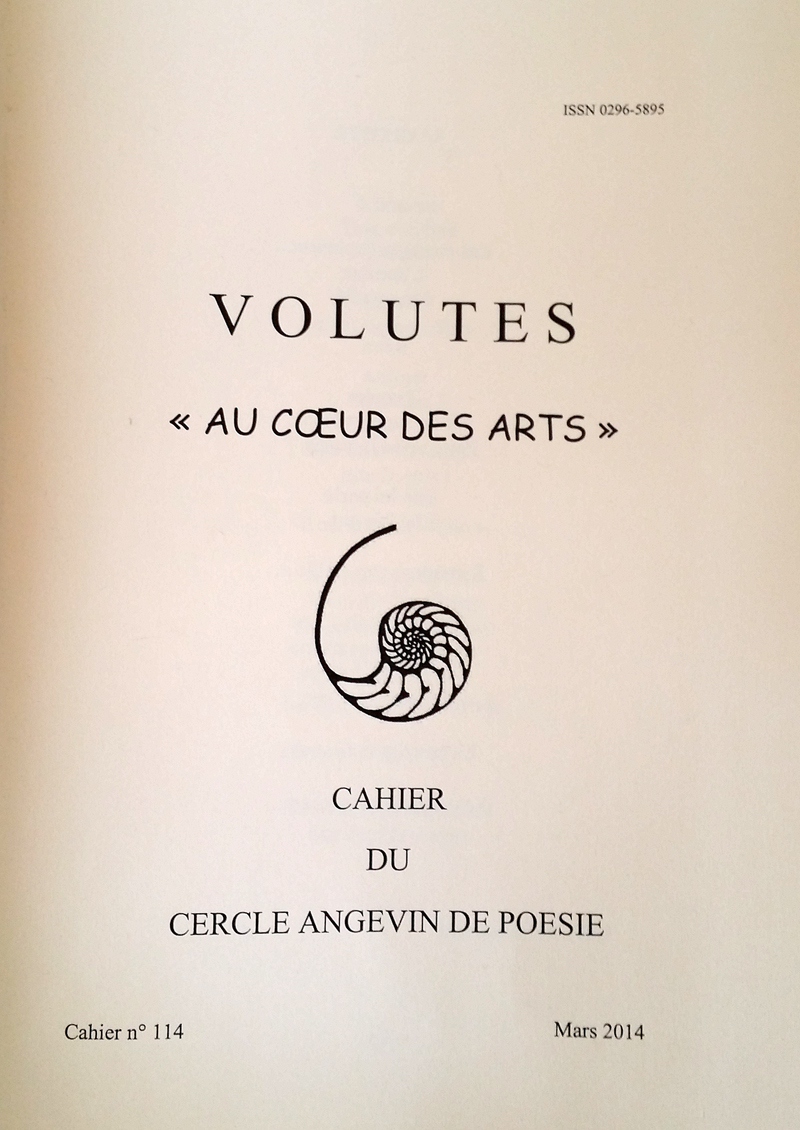
Cela fait de nombreuses années que le Cercle Angevin de Poésie édite une revue présentant les travaux de ses membres dans une revue trimestrielle. Comme PluMe aime à promouvoir toutes les écritures littéraires, il eut été dommage de ne pas l’évoquer. Le Cercle Angevin de Poésie est en effet la plus ancienne association poétique de la ville d’Angers et est aujourd’hui riche d’une longue et belle histoire.
Le Cercle Angevin de Poésie a été créé dans les années 80 par un groupe d’amis poètes dont les fondateurs, Roger Bonhomme (à l’origine du fameux prix de poésie de la Ville d’Angers), Alain Debroise, Jean Benoît, Gilles Morcrette et Jacques Terrien avaient pour ambition de diffuser la poésie – notamment angevine – dans l’esprit des poètes de Rochefort.
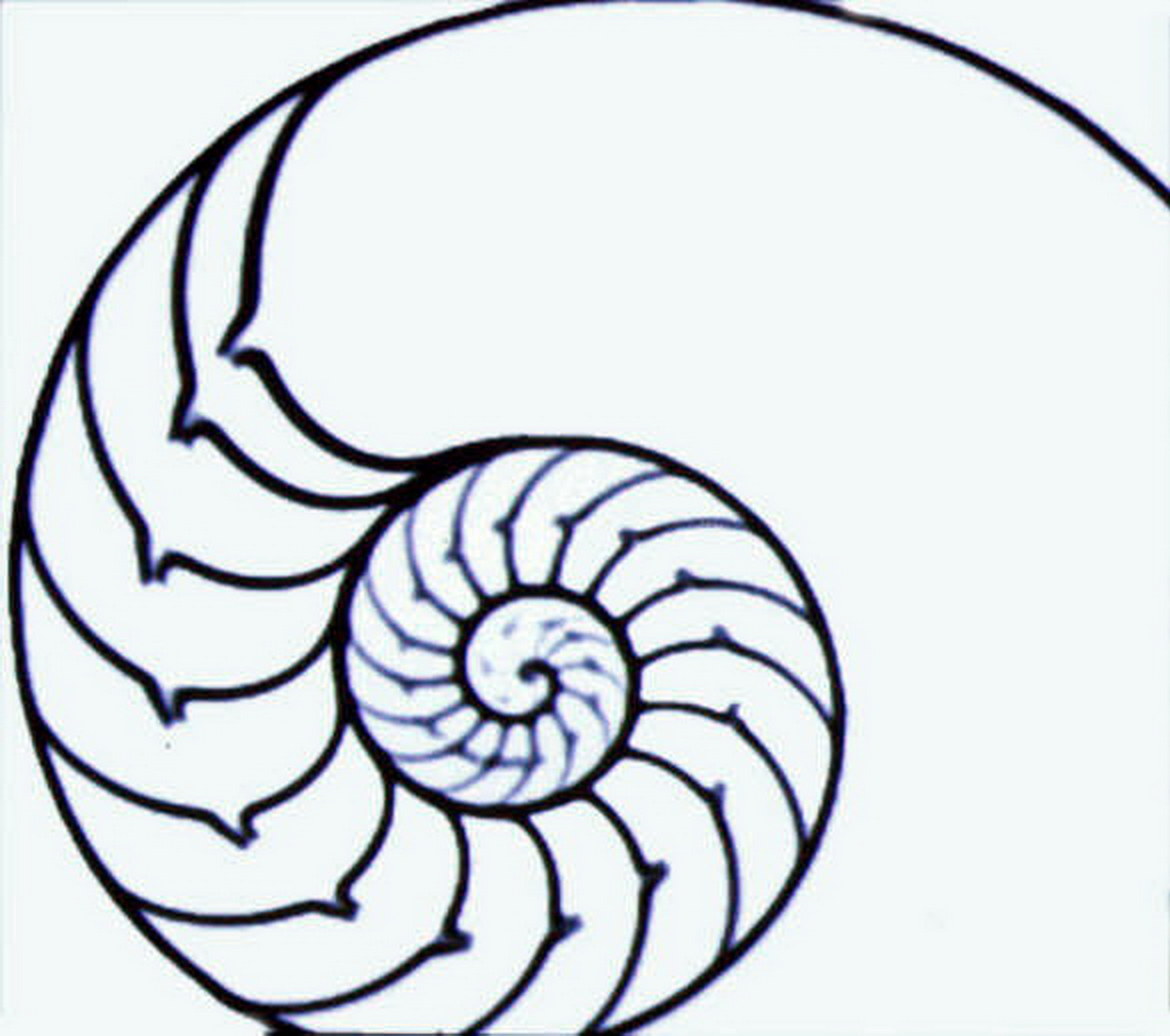
Depuis sa naissance, le Cercle Angevin de Poésie a accueilli un grand nombre de poètes enracinés en Anjou. Il a créé beaucoup de spectacles poétiques, notamment chaque année à l’occasion du Printemps des Poètes. Il a souvent participé au prix de poésie de la ville d’Angers.
Très vite, il s’est avéré que la diffusion de ces travaux poétiques méritait une revue. Volutes a donc été créé à cette occasion (ISSN 0296-5895). La revue Volutes présente les travaux du Cercle tous les trimestres.
Extrait de la revue Volutes du mois de mars 2014 – n°114
L’Artiste
Les couleurs explosent…
L’homme
Emerveillé
Rêve.
Recréer
Sur un support blanc,
Faire vivre la nature ?
Elle lui parle
Elle l’émeut.
Il voudrait être « Elle ».
Il n’entend plus rien
Il cueille les parfums
Il s’inonde d’attente
Il caresse le vent.
La passion le féconde.
Les couleurs explosent…
L’homme
Tout enfiévré
Frémit.
Recréer
Sur un support blanc ?
Animer
La nature ?
Elle lui a murmuré..
Elle l’a pris !
Il est devenu « Elle ».
Il n’entend plus rien
Il cueille les odeurs
Il s’enfouit de douceur
Il respire le vent.
La passion le transcende
Et
Les couleurs explosent
Sur la toile vierge.
Roselyne DEMATTEO
Extrait de la revue Volutes du mois de mars 2014 – n°114
Pygmalion
Dans le marbre, sculpter la promesse des songes,
Arracher à la pierre un peu des ciels perdus,
Ajouter ce qui manque à la beauté du monde
Et cueillir le trésor que nos yeux ne voient plus.
Tel est le rêve obscur des mains qui, dans l’argile,
Et le bronze couleur de l’ambre ensoleillé
Fixent le tendre éclat d’un visage fragile
Ou l’image sans nom qui traverse les nuits.
Lutteur qui, sans repos, braves la pierre ingrate,
Prince dont les amours se voilent de silence,
Toi qui fais la beauté d’une brève apparence,
Ton vouloir obstiné trace sur nos hivers
Ses poèmes de marbre aux formes invincibles
Et tes mains sont le fleuve où cessent nos déserts.
Jacques TERRIEN
Le Cercle est ouvert à tous ceux qui écrivent de la poésie, classique ou non, régionale ou non. Un seul prérequis : être passionné par la chose et motivé. Vous découvrirez d’autres passionnés, et profiterez aussi de belles lectures de textes connus ou moins connus dans l’optique du partage.
Avec l’aimable autorisation des auteurs et de l’association.
Le sonnet : une forme impossible ?